Ayant transformé notre camionnette en confortable petit camping-car, muni de réserves d’eau et de carburant, nous comptions, Marie Céline et moi, gagner Saint-Louis du Sénégal en longeant les côtes maghrébine et mauritanienne de l’Atlantique. Début décembre 1998 nous traversons l’Espagne et le Maroc, mais nous trouvons bloqués par les autorités à La Ayoune du fait du conflit avec les Sahraouis et le Polisario. La route de l’intérieur nous est formellement déconseillée, étant trop dangereuse à cette période. Pour aller à Nouadhibou, il nous faudrait attendre trois semaines et être incorporés dans un convoi escorté de militaires armés. Cette perspective ne nous séduit pas et nous décidons, à regret, de rebrousser chemin.
Notre première surprise est de constater que l’important vol de sauterelles que nous avions traversé et un peu écrasé la veille au soir est complètement dégagé le lendemain matin, le service de voirie étant, oh miracle !, assuré par une armée de rats nichant dans des terriers alentour et qui nuitamment se sont régalés de l’aubaine. Nous remontons au nord par Tarfaya, Tan-Tan, Tiznit.
Une seconde surprise nous attend dans le Sud marocain : la neige ! Dans la vallée du Draa, à Ouarzazate, elle tombe abondamment durant deux jours en une couche épaisse de 15-20 cm. Le service local des Ponts et chaussées est mal équipé pour parer à cette situation inattendue ; en outre, les conducteurs marocains n’y sont guère habitués. Il s’ensuit des embouteillages monstres qui nous bloquent une seconde fois aux abords de Tazenakht. Usant d’audace et plus encore d’impertinence, je double hardiment toutes les files d’attente et sors de l’immobilité qui devenait peu à peu une glacière. Nous admirons ensuite les merveilleux paysages du flanc sud de l’Atlas et de la vallée du Dades. Non loin d’Erfoud, nous nous arrêtons à l’étal d’un berbère qui offre des fossiles et des minéraux dont Marie Céline est si friande. Le marchandage n’en finit pas. Le rusé « minéralogiste » lui demande la lune pour une demi-douzaine d’échantillons (dont une belle dent de requin astucieusement collée sur un support calcaire). Au terme de ce challenge très indécis Marie Céline revient vers le camping-car clopin-clopant ; elle a sacrifié sa paire de chaussures contre quelques kilos de cailloux. Elle est toute radieuse de cette bonne affaire. Après des centaines de kilomètres de pistes pierreuses ou sablonneuses, nous gagnons la magnifique oasis de Figuig, riche de 80 000 palmiers-dattiers, et poste-frontière avec l’Algérie. C’est la veille de Noël, mais en guise de messe de minuit – jamais deux sans trois – un nouveau blocage nous y attend. Des Marocains de rencontre (qui deviendront des amis : Ahmed et sa famille) nous voyant partir pour le pays voisin nous demandent si nous avons de l’argent marocain, en vue de nous mettre en garde.
« Oui, car après une petite semaine algérienne nous reviendrons par Oujda et Ceuta. »
« Alors, cachez le bien dans vos chaussettes, sinon ces bandits vous prendront vos dirhams ».
Forts de ce bon conseil nous traversons la palmeraie, zone de no man’s land d’une dizaine de kilomètres, et arrivons vers 18 heures au poste-frontière de Beni-Ounif pour les formalités de police et de douane qui ont lieu dans deux baraquements différents. Par chance, nous sommes presque seuls, uniquement devancés par un Malien dont la 504 break est archibondée de denrées de toutes sortes, y compris la galerie, et un voyageur allemand qui bavarde avec les autorités. Ce ne sera pas long. Hélas ! Je me trompe lourdement. Pour une raison inconnue, la discussion perdure indéfiniment entre l’Allemand et les Algériens. Impatient, je m’approche et constate l’incompréhension : l’Allemand ne parle ni l’arabe ni le français. J’offre mon intermédiation, rassemblant tous mes souvenirs de la langue de Goethe. Le voyageur veut entrer en Algérie, mais il n’a pas de visa, ce précieux sésame indispensable. Il supplie, il tempête, mais vainement. Dura lex, sed lex. Il est parvenu au poste-frontière en taxi, dont le chauffeur est reparti et se trouve isolé, sans aucun moyen de communication. La porte d’entrée de l’Algérie lui étant définitivement refusée, je lui propose aimablement de le raccompagner à Figuig, ce qu’il accepte avec philosophie et la mort dans l’âme.
« Je n’ai jamais vu ça ! me dit-il ; je suis ethnologue-anthropologue et je viens d’Afrique du Sud. Depuis deux ans, je remonte en zig-zag, vers le nord, au travers de tout le continent pour étudier les différentes ethnies et les populations africaines. J’ai toujours été bien accueilli… sauf ici dans ce fichu pays. »
Je le dépose à Figuig au pied d’un campement et reviens à Beni-Ounif alors que la nuit tombe. Le Malien est assis sur une de ses valises ; tout son barda est dispersé sur le sol autour de sa voiture. La tête entre les mains, effondré, découragé, le brave noir me dit, mélancolique :
« Ils ne m’aiment pas ! Ces salauds, parce que je suis un nègre. »
En outre, on ne sait pourquoi, les policiers se sont absentés… peut-être pour dîner. Nous sommes contraints de patienter de longues heures courbant l’échine sous un vent froid d’hiver, un vent du désert presque glacial. A leur retour, vers 23 heures, le Malien est condamné à remballer son matériel et à s’en retourner d’où il vient n’étant pas admis à pénétrer en territoire algérien. Nous n’avons pas le cœur à nous lamenter sur son sort, car c’est, enfin, notre tour.
« Avez-vous de l’argent marocain? »
« Non, nous avons tout dépensé. »
Suit un silence un peu angoissant, car nous craignons la fouille, surtout Marie Céline… Non.
« Avez-vous des dinars ? »
« Non, pas encore ; mais nous souhaitons en acheter. »
« Vous devez avoir au minimum 1500 dinars par personne. »
« Soit ! Nous voulons bien obtenir 3000 dinars. »
« Avez-vous de l’argent français? »
« Oui, nous avons 4500 francs. »
Je les extrais de mon portefeuille et les compte devant les policiers. Ils détournent les yeux ; puis prennent en main les billets et les recomptent eux-mêmes deux fois. La confiance ne règne pas ! Néanmoins un policier nous remet 3000 dinars ainsi qu’un document indiquant qu’à notre entrée nous disposons encore de 3100 francs. Toute nouvelle opération de change dans une banque algérienne devra être mentionnée sur ce document qui sera l’objet d’un contrôle lors de notre sortie. S’il nous reste alors des dinars, ils seront sans valeur, la monnaie algérienne n’étant pas convertible à cette époque.
« Et avez-vous une assurance pour votre véhicule ? »
« Oui, bien sûr, nous avons la carte verte. »
« Donc, vous n’avez pas d’assurance ! »
« Mais si !, voyez, voici notre carte verte. »
« Elle n’est pas valable … regardez bien, en bas, en petites lettres, il est mentionné : « à l’exception de : Afghanistan, Algérie, Birmanie. Il vous faut prendre une assurance algérienne ; c’est 500 dinars. »
Bon gré, mal gré, il faut y passer. Il est plus de minuit quand nous quittons le bâtiment pour nous rendre à celui de la douane. Mais il est fermé, les responsables n’étant pas rentrés de leur festin de Noël. Seuls dans le froid saharien, nous attendons le bon vouloir des douaniers. Ils finissent par arriver et nous délivrent un laissez-passer. Ouf ! Ce feu vert obtenu, nous fonçons dans la nuit noire vers Ain-Sefra, petite ville dangereusement menacée par une dune de sable de plus de cent mètres de hauteur. Avant d’y parvenir, nous sommes pistés et arrêtés inopinément, à deux reprises, par des contrôles volants auxquels il faut montrer que tous nos papiers sont en règle. L’état policier transpire déjà à plein nez. Nous verrons plus loin le résultat d’une économie sans croissance, totalement étatique et dépendante des revenus gaziers et pétroliers. Le lendemain, vers 18 heures, nous arrivons à Oran et demandons à un agent de la circulation de nous indiquer un hôtel.
« Il y en a plus de cinquante ici ! » nous dit-il fièrement.
« Un bon hôtel restaurant, simplement »
« Prenez à droite, cette large avenue de la Libération ; longez la baie des Victoires et vous parviendrez au merveilleux complexe touristique que nos amis soviétiques ont offert à la nation algérienne. Vous verrez, c’est grandiose ! »
Nous ne pouvons rien voir de la tristement célèbre rade de Mers el Kébir, cachée, on se demande pourquoi, aux yeux des touristes par des palissades et des camouflages. Nous aboutissons devant un ensemble de bâtiments imposants, d’architecture austère, dont les abords engazonnés et parcimonieusement fleuris sont silencieux et déserts. Nous sommes atterrés de l’atmosphère triste, sinistre, de cet énorme complexe dénué de vie et d’animation, menacé de décrépitude, bien que tout récent. Garant notre camping-car près de l’entrée principale, je suggère à Marie Céline de m’attendre un moment, le temps d’explorer les lieux. J’entre dans un vaste hall au fond duquel se trouve le guichet d’accueil. Deux employés y sont assis, bavardant. Tout est vide alentour. Je m’approche du guichet toussotant pour marquer ma présence au cas, improbable, où elle n’aurait pas été observée. Le bavardage entre les deux réceptionnistes qui feignent ostensiblement de m’ignorer dure exagérément ; il est factice, volontairement et délibérément désagréable. Je tourne alors les talons et sans un mot me dirige vers la sortie.
« Vous désiriez quelque chose ? » vocifère alors l’un des employés.
« Oui; avez-vous une chambre pour deux personnes ? »
« Nous en avons 1 300, Monsieur ! Quel type de chambre voulez-vous ? »
« Avec un grand lit, une salle de bains, de l’eau chaude. » Ma réponse suscite une réflexion et un conciliabule entre les deux plantons.
« Nous sommes en pleine période creuse, au ralenti ; nous ne pouvons avoir de l’eau chaude que dans une vingtaine de minutes. »
« Ok ! Ce n’est pas grave. »
Je vais informer mon épouse de ce léger contretemps. Elle a grande envie de prendre un bon bain chaud, ce dont nous sommes sevrés depuis deux semaines ; elle accepte de bon gré ce sursis d’une petite demi-heure. De retour dans le hall de ce gigantesque hôtel, je vois un bel individu en complet-veston, visiblement le chef.
« Désolé, Monsieur, il ne peut y avoir d’eau chaude… (un silence)… et il n’y a pas d’eau froide non plus ! »
Nous dormirons donc de nouveau dans nos sacs de couchage avec notre crasse ; mais en ce lendemain de Noël, nous pouvons tout de même nous offrir un bon dîner ! Le restaurant est à une centaine de mètres. Il est immense et toutes les tables sont prêtes à recevoir les clients. Cependant dans cette grande salle désespérément vide une seule est occupée. Nous en choisissons une à l’écart, assez éloignée. Le maitre d’hôtel vient vers nous pour prendre commande.
« Nous voudrions une bonne « pastilla » et un tajine pour deux personnes. »
« Impossible ! »
« Comment donc ? »
« Ce soir, c’est plat unique : dinde aux marrons. »
Stupeur et désillusion. Nous espérions nous régaler d’une spécialité arabe bien épicée… mais nos estomacs crient famine et plaident en faveur du plat unique complété d’une entrée et d’un dessert. Nous savourons notre dinde avec un plaisir mitigé, car réchauffée elle est plutôt tiède que chaude. Il s’agit de restes de la veille.
Entre alors un bel Algérien en costume cravate, un personnage, à l’allure dégagée et suffisante, presqu’un sosie d’Omar Sharif. Ayant jeté un coup d’œil dans la salle vide, il vient s’asseoir à la table voisine de la nôtre ; il a droit, lui aussi, à la dinde aux marrons, assortie toutefois d’une bouteille de Bordeaux. Au bout d’un moment, après nous avoir furtivement observés et identifiés, il engage la conversation.
« Bonsoir ! Vous êtes touristes ? »
« Effectivement. »
« De la métropole ? »
« Oui; nous passons une petite semaine en Algérie. »
« Parfait ! Nous pouvons bavarder. Puis je vous offrir quelque chose ? »
« C’est bien aimable de votre part; mais nous avons fini de diner; c’est plutôt à nous de vous offrir… »
« Eh bien, merci… disons… une autre bouteille de Bordeaux. »
Le bel homme est très disert. Il nous explique qu’il est producteur de films pour la télévision d’état algérienne. Une grasse sinécure ! Il a par ailleurs un’ « petit commerce »’. Avec son physique avantageux, il aurait très bien pu être acteur. Du reste, les Américains, l’ayant repéré, lui avaient offert un premier rôle dans un western à Los Angeles ; mais à la demande des autorités du Parti, il est allé en stage d’abord à Prague, puis à Moscou, enfin au Yémen « pays du communisme extrême » nous dit-il.
Un peu lasse de ces rodomontades, Marie Céline lui demande gentiment :
« Êtes-vous marié ? »
« Bien sûr ! J’ai une première femme qui m’a donné deux enfants et qui tient le magasin… j’ai une seconde femme, plus jeune… plus moderne… elle est professeur ! »
A ce moment, notre interlocuteur fait un signe au garçon et, en arabe, lui passe une petite commande. Quelques minutes plus tard, le garçon revient, la mine grincheuse, et s’exprimant intentionnellement en français pose auprès de Marie Céline quelque chose enveloppé dans un papier journal.
« Voilà le sandwich pour Madame. » dit-il avec mépris.
Marie Céline se défend aussitôt d’avoir jamais commandé quelque sandwich que ce soit.
« Non, non, intervient le bel oiseau ; c’est pour ma seconde femme… qui attend dans la chambre. Il faut qu’elle se restaure un peu ! »
Quel culot ! Quel machisme ! Quel effroyable cynisme ! Tandis que la jeune enseignante épousée se morfond solitaire dans la chambre, Monsieur le bellâtre s’octroie un gueuleton bien arrosé et disserte généreusement ! Indignés, dégoutés, scandalisés, nous quittons derechef sans même un « au revoir ».
Le lendemain, nous visitons la jumenterie de Tiaret que j’avais vue si florissante, il y a un demi-siècle, comme l’un des berceaux de cette fière et superbe race arabe. Elle est maintenant abandonnée. Quelle tristesse ! Durant notre absence notre véhicule est forcé et cambriolé. Heureusement nous avions soigneusement caché nos papiers essentiels – passeports, documents financiers… – et le voleur, peut être dérangé, n’a dérobé que des dinars. En conséquence, nous devons refaire le plein dans une banque d’Etat qui inscrit notre retrait sur le précieux bulletin qui sera minutieusement examiné à notre sortie. Par précaution, et pour la même raison, nous déclinons, dans un bon restaurant de Tlemcen, l’offre réitérée du maître d’hôtel de nous faire une réduction de 30 % si nous payons discrètement en argent français. Si nous avions succombé à une telle tentation, nous l’aurions payé très cher. Ayant fait un pèlerinage à la Médersa dont mon grand-père Maurice fût le fondateur et le premier directeur, nous repartons sincèrement attristés du comportement de l’actuel proviseur, haut dignitaire du parti, qui ose qualifier mon aïeul d’affreux colonialiste au motif qu’il formait des élites appelées à servir l’administration coloniale. Le cœur gros, nous nous dirigeons sur Alger et faisons halte à la station balnéaire de Sidi Ferruch. Il s’y trouve à nouveau un immense complexe hôtelier touristique offert par le « grand camarade ». Il est tout aussi désert que celui de Mers el Kébir. On y sert encore et toujours exclusivement la dinde aux marrons, car il faut épuiser les stocks. Nous insistons néanmoins pour passer outre et obtenons à grand-peine la promesse d’un couscous aux sept légumes; cependant, il faudra patienter une grosse demi-heure. J’en profite pour visiter l’endroit et fais le tour de la piscine « olympique » dont l’eau est verte et peuplée d’algues abondantes et nauséabondes. Quelques éléments de carrelage sont fendus ou décollés. Quelle négligence, quel abandon, quel gâchis ! Je suis dans mes réflexions quand je sens soudain derrière moi une présence. Manifestement ce grand gaillard endimanché est le directeur de ce centre.
« Voulez-vous vous baigner ? » me demande-t-il.
« Oh! Que non ; pas dans une eau aussi dégoutante. »
« Mais les Russes, eux, ça ne les gêne pas. » rétorque-t-il.
Ayant repassé la frontière sans trop d’encombres, nous faisons un détour par l’ancienne cité romaine de Volubilis avant de reprendre le ferry-boat à Ceuta. A quelques kilomètres de là, en abordant une côte, nous sommes considérablement retardés, presqu’immobilisés par un camion plus que poussif. Malgré la ligne jaune et en pleine visibilité, je le double. Hélas, au sommet de la colline, deux mohrasnis nous sifflent et nous arrêtent, ainsi que le camion qui suit. Je me range sagement sur le côté.
« Vous avez franchi la ligne jaune… vos papiers. »
« C’est vrai, mais en toute sécurité; nous avons dépassé ce camion qui n’avançait pas. »
« Vos papiers: passeports, permis de conduire, assurance…. »
J’obtempère. Le sergent mohrasni conserve mon permis de conduire.
« Vous irez le chercher demain au poste de police de Meknès après avoir réglé l’amende. »
« Je veux bien régler l’amende immédiatement. »
« Non, demain au commissariat de Meknès. »
« Impossible ! Car demain nous devons être à Ceuta pour prendre le ferry; nos places y sont retenues.
« J’ai dit demain… à Meknès …. »
Nous voilà frais. Quelle poisse ! Nous allons louper le bateau. Que faire ? Patienter ? Attendre ? Espérer une conciliation ? Le temps passe sans qu’aucun véhicule ne vienne troubler le silence pesant. Plus d’une demi-heure s’écoule avant que le sergent s’avance pour contrôler le camion ; il le laisse partir. Enfin seuls ! Sans témoins. Bien maladroitement, je me décide à tenter d’amadouer les deux policiers. J’entame la conversation. Quel beau pays que le Maroc; et les Marocains sont tellement sympathiques ! Les visages se dérident un peu. Je m’enhardis
« Au commissariat de Meknès, vous avez peut-être… une caisse de secours et de bienfaisance ? »
« Assurément. »
« Nous aimerions y faire une petite offrande. Est-ce possible ? »
« Excellente idée … »
«… pour nous faire pardonner notre malencontreux dépassement de ligne jaune. »
« Vous devez réparer vos torts, d’une manière ou d’une autre. »
J’offre alors quelques centaines de dirhams au sergent qui sourit et me rend mon permis. Mais l’autre policier réclame:
« Et moi ? »
Au terme de notre périple, nous n’avons plus guère de ressources, hormis une cartouche de cigarettes et une bouteille de whisky. Nous les lui offrons.
« C’est tout ? » s’indigne-t-il esquissant néanmoins un sourire.
Nous nous quittons bons amis. Nous traversons ensuite les montagnes du Rif ou presqu’à chaque virage des sachets de haschich nous sont proposés parfois avec insistance, voire véhémence. Nous arrivons à Ceuta en temps voulu. Sur le quai d’embarquement les véhicules sont à la queue leu leu. Des douaniers espagnols accompagnés de chiens bergers au flair délicat patrouillent le long de la file. Un jeune marocain frappe à la fenêtre de notre auto et nous propose des blousons de cuir. Nous n’en voulons pas.
« Je prends aussi le bateau. Je vous les confie. Vous pourrez choisir. Je vous ferai un bon prix. »
« Non merci, nous n’en voulons pas. »
« Je vous en donnerai un en cadeau. Tout ce paquet est un peu lourd à porter. »
« Non, encore une fois. »
Ouf ! Nous l’échappions belle, car un chien reniflait manifestement le jeune homme, ayant décelé la présence de drogue. Le bougre était aussitôt emmené et son paquetage confisqué.
Commentaire
Le baril de pétrole cotait alors 35 US dollars, un point mort bas momentané. En Algérie, tous les chantiers en cours étaient interrompus. Des kyrielles d’hommes désœuvrés, au chômage, bordaient les rues, mélancoliques, les femmes restant cloitrées à la maison. Triste spectacle. Malgré cela, notre séjour au Maghreb a été un moment délicieux. Non loin de Marrakech, un jeune Marocain n’avait-il pas frappé à la fenêtre de Marie Céline en lui criant :
« Oh! Ma belle gazelle, je t’aime, je t’aime, je t’aime ! »
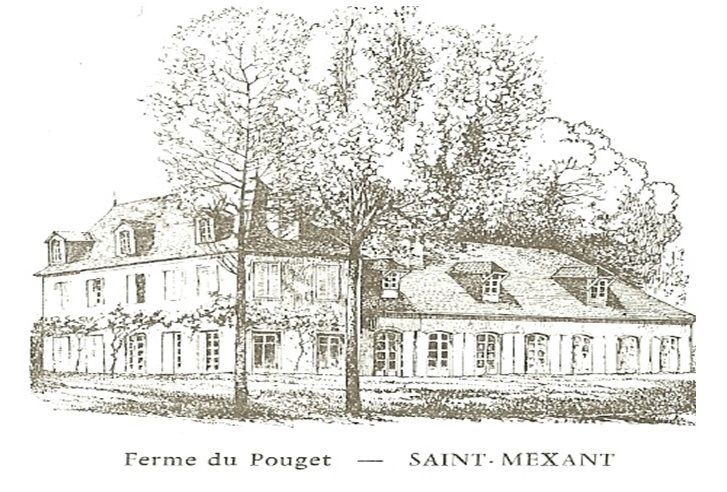
Philippe Demombynes

Ajouter un Commentaire