Présentation d’ouvrage par Robert Schilling
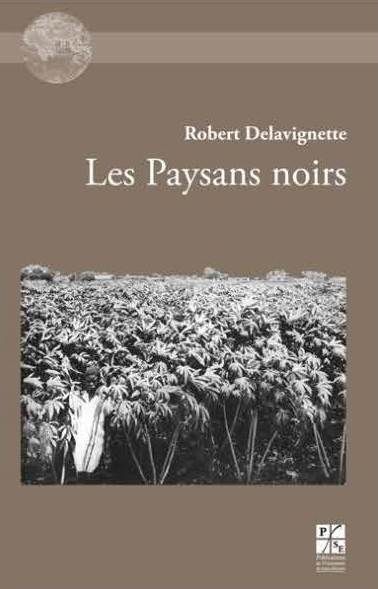 Les Paysans noirs
Les Paysans noirs
Robert Delavignette
Publications
de l’Université
de Saint-Etienne
2011, 213 p.
En ce début du xxe siècle, un administrateur colonial (l’auteur) est nommé à la tête de la subdivision administrative de Banfora, au sud de Bobo-Dioulasso, dans l’actuel Burkina Faso. Il fait part de son expérience sous forme de lettres adressées à son épouse restée en France. Son domaine : neuf cantons et cent dix villages. Ses administrés : des chefs de cantons et des chefs de villages musulmans appartenant à l’ethnie dominante Dioula ; une douzaine de Blancs en haut ; en bas, une masse confuse de cent mille Noirs dans leurs trois mille quatre cents soukalas, pauvres huttes isolées en brousse, véritables cellules vitales du pays. Là vivent, en vassaux, les paysans fétichistes : Gouins, Sénofos, Turkas et autres, travaillant sur le champ collectif du Dioula et sur leurs maigres lopins. L’implantation d’une huilerie perturbe ce petit monde, car pour nourrir la « machine » des Blancs, il faudra produire six mille tonnes d’arachides par an, sur les champs des seigneurs ou sur les lopins individuels, nécessairement au détriment du mil nourricier. Comment intéresser la masse paysanne au projet, comment ravitailler cette Machine extraordinaire sans léser gravement la majorité, alors que la chefferie dioula y voit le moyen de renforcer encore son pouvoir ? Comment faire de cette huilerie un instrument de progrès et d’émancipation unissant tous les hommes du pays, les Noirs et les Blancs ? Les corvées se sont multipliées, car il a fallu tracer des pistes, construire des ponts, des bacs et des magasins villageois, constituer des stocks de semences placés sous la surveillance des anciens tirailleurs ! De ces troupeaux de porteurs et de manœuvres montait une crainte et un espoir : Est-ce vrai que cette nouvelle « manière-Blanc » nous rapportera quelque chose de bon ? Est-ce vrai que nous vendrons l’arachide pour de l’argent, plutôt que d’aller louer nos bras sur les plantations de la côte, seule manière de payer l’impôt et la dot de nos épouses ? Dans le même temps, les patrons de la CFCI (Compagnie française de la Côte d’Ivoire), maîtres d’œuvre de l’entreprise, négociaient âprement le prix payé aux producteurs : « Le chemin de fer est encore trop loin »… « L’année est mauvaise »… « Les cours mondiaux sont à la baisse »… Les paysans, pris dans l’engrenage de l’économie mondiale, dépendent désormais de forces qui leur échappent.
L’administrateur – le « commandant » –, non sans mal, a su gérer ces problèmes. L’argent de la « machine » coule désormais sur le pays. Certes les chefs et les riches en ont la grosse part, mais les pauvres ont ce qu’il faut aux pauvres. Des querelles de générations sont venues compliquer la situation, car les jeunes gens travaillaient traditionnellement sur les champs de leur futur beau-père pour obtenir la main de leurs promises. Or le revenu de l’arachide étant encaissé par les « vieux », chefs de soukalas, les jeunes hommes n’en voyaient pas la couleur, dans une économie désormais en voie de monétarisation. Il y avait bien des mariages, mais c’étaient souvent les vieillards, enrichis par l’arachide, qui accaparaient les filles et les épousaient. L’argent circulait entre vieux, et le garçon qui n’avait que ses bras pour fonder une famille devait renoncer à célébrer ses noces, sauf à s’enfuir avec sa promise pour fonder une soukala rebelle. Les tribunaux ne chômaient pas… Les bases de la société traditionnelle en furent ébranlées, mais les soukalas des jeunes ménages se multiplièrent. Elles ne ressemblaient plus aux vieilles, elles n’étaient plus une tribu sous l’autorité d’un patriarche, mais un ménage qui suivait la coutume à sa manière, cultivant l’arachide contre rémunération en espèces. Les paysans noirs ont pu, progressivement, concilier les coutumes communautaires avec leur forme familiale de propriété, et ainsi marier leur mode de vie africain avec l’usine des Européens.
L’édition 2011 de la version 1947 de ce livre trop peu connu – dont le première édition date de 1931 et qui a donné lieu au tournage d’un film sorti en 1949 – est suivie d’une intéressante postface de Janos Riesz, qui présente la personnalité et le profil de Robert Delavignette, fonctionnaire de terrain. Promu directeur de l’Ecole de la France d’Outre-mer en 1937, Il fut ensuite associé, à un haut niveau, à la politique coloniale de la France. Son ouvrage joua un rôle dans le processus de décolonisation comme modèle d’une coopération technique à venir, non sans susciter quelques critiques. L’auteur sénégalais Ousmane Sembène, notamment, a mis en garde, dans son roman O pays, mon beau peuple, contre la tentation de plaquer en Afrique, au nom d’une conception du « développement » qui se voulait universelle, des recettes et des innovations venues d’ailleurs. Ce sont les forces vives de la société africaine qui doivent prendre l’initiative du changement.

Ajouter un Commentaire